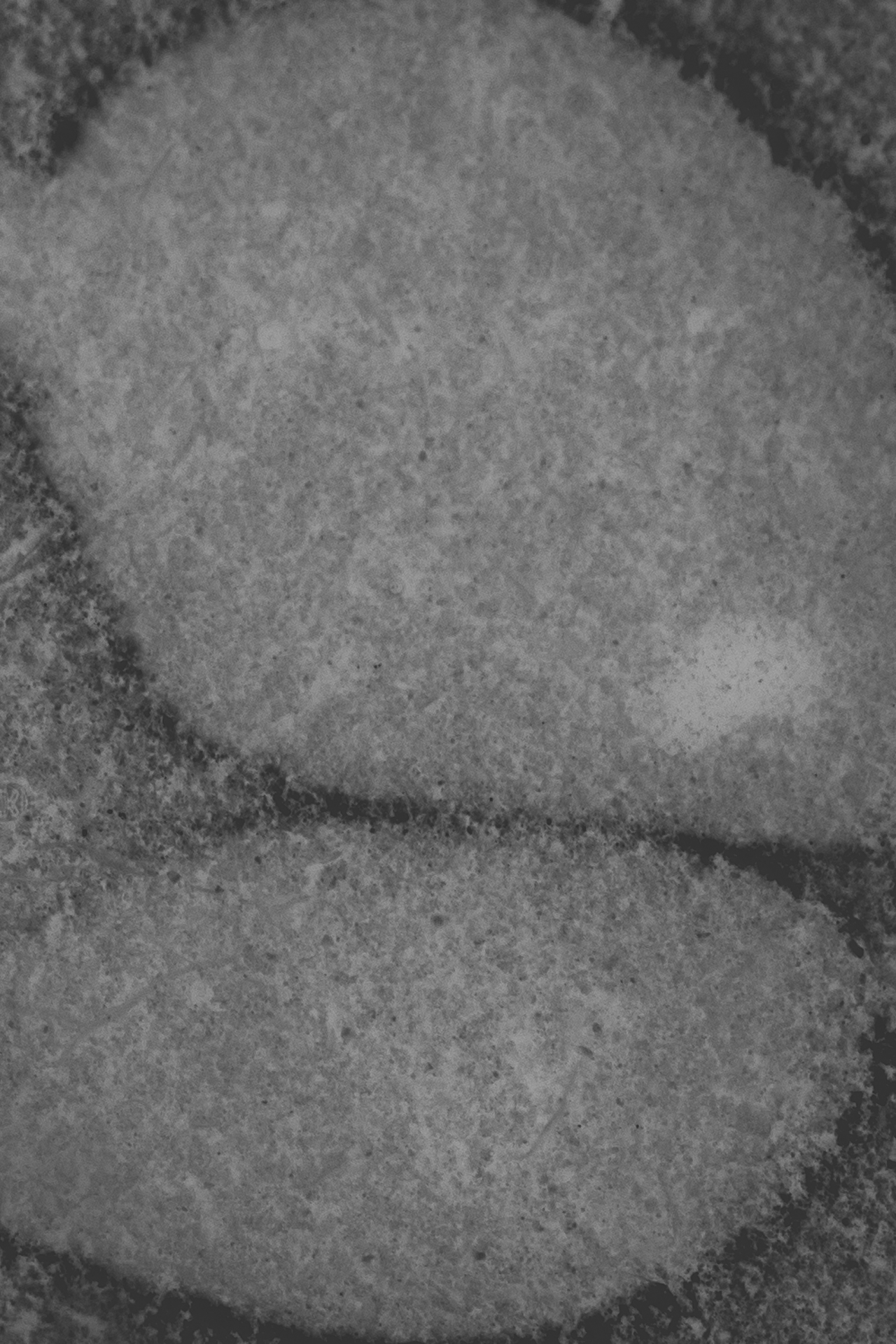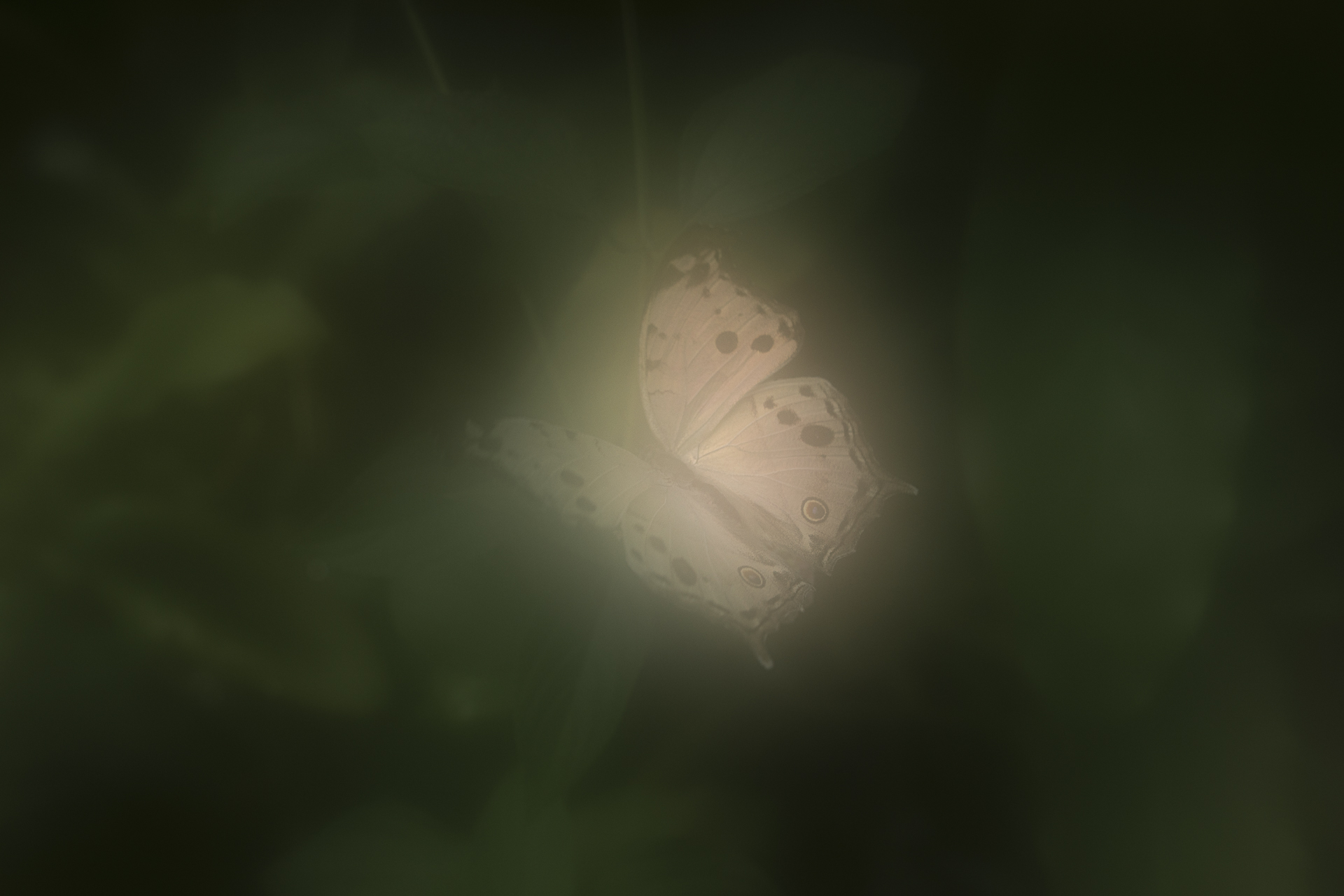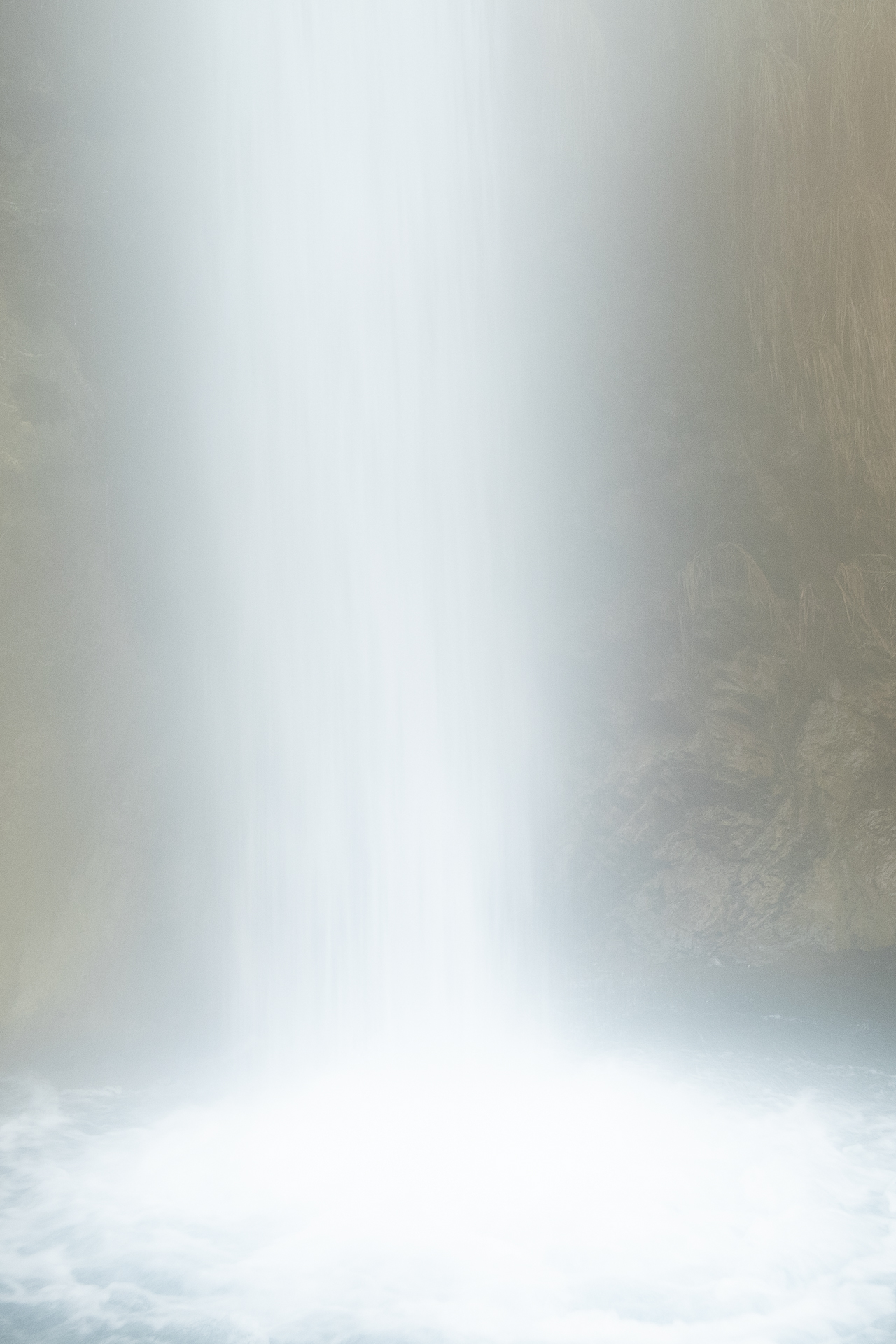« Tu sais que le mot poiêsis a de nombreuses acceptations : il exprime en général la cause qui fait passer quoi que ce soit du non-être à l’être* ».
Poiêsis est avant tout une tentative pour représenter la pensée dans son éphémérité, qu’elle paraisse sous la forme d’un rêve, d’une idée, « d’une chose relativement inconnue que l’on ne saurait […] désigner d’une façon plus claire** .» Chaque chose pensée est alors une image qui n’a la certitude de rester, de s’achever dans la réalité car ne pouvant vivre pleinement que dans l’imagination. Ainsi, ces visions nous paraissent vagues et vaporeuses, mais trouvent dans les symboles les signes concrets de la pensée profonde.
Ce projet fait indirectement référence à la peur d’entreprendre quelque chose déjà voué à mourir. Conscient du destin tragique des images mentales, l’acte photographique s’incarne comme un remède, une forme d’autopsychanalyse transformant la peur d’agir en moteur créatif. Les photographies deviennent des fragments de pensées se métaphorisant dans la nature, les plantes et les matières, seuls espaces tangibles où peut s’étendre matériellement le rêve.
Ces matières — végétales, aqueuses — sont autant de lieux de rencontre aux ambivalences. L’eau symboliquement est utilisée comme langage à part entière, une forme d’expression plus profonde, plus intime encore, permettant de figer des manifestations de l’esprit en des images semblables, muettes.
Ainsi, la nature et la conscience deviennent des entités jumelles. Elles se répondent d’une façon étrange et complexe, pour percer ce qui dans nos rêves persistent sous forme de mirages, images fumeuses au caractère chimérique et magnifiant.
Ce projet photographique interroge les notions de doute, de métamorphose et de quête de sens à travers le prisme d’une introspection profonde. Nourri par la pensée de Bachelard et son ouvrage L’eau et les rêves, Poiêsis s’inscrit dans une démarche quasi initiatique, cherchant dans la nature une résonance intime. Cette création poétique, au sens grec du terme — faire advenir à l’être —, devient un recueil d’images où le rêve trouve matière à s’incarner, révélant une pensée en mouvement.
|*Platon. (1873). Le Banquet (Dacier et Grou, Trad.).
|** Durand, G. (2015). L’imagination symbolique. Puf.